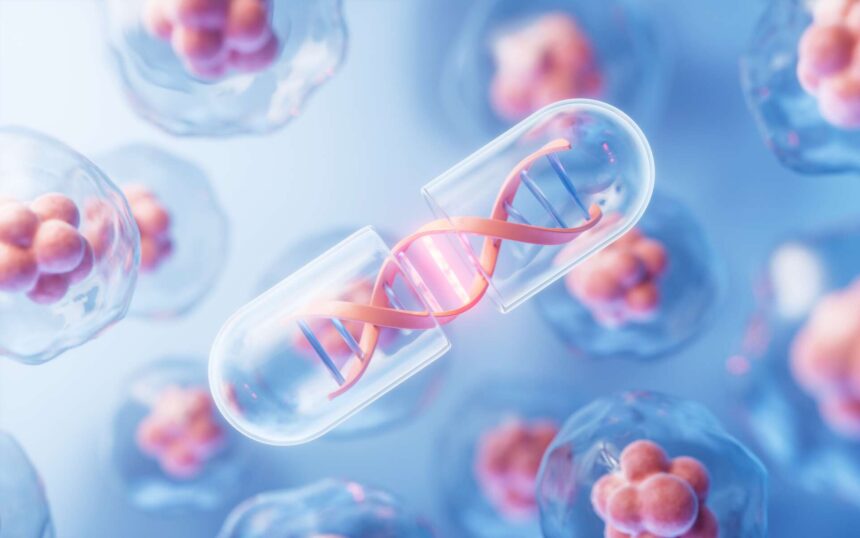Les thérapies géniques sont souvent associées aux maladies génétiques rares, ce qui pourrait laisser penser qu’elles ne concernent qu’un nombre restreint de patients à travers le monde.
Cependant, comme le montre l’étude prospective du LEEM, ces thérapies sont amenées à révolutionner la prise en charge de très nombreuses pathologies. Dans un avenir proche, elles pourraient offrir des solutions thérapeutiques innovantes pour divers types de cancers, des troubles neurologiques, des maladies cardiovasculaires, des pathologies métaboliques comme le diabète, ainsi que pour des infections graves telles que le VIH.
Voici un aperçu des perspectives d’application des thérapies géniques en 2025.
De la réparation des gènes aux nouvelles stratégies thérapeutiques
À ses débuts, la thérapie génique se concentrait sur la correction de mutations responsables de maladies monogéniques, causées par un seul gène défectueux. Désormais, elle s’adapte à des pathologies plus complexes impliquant plusieurs gènes et même des facteurs environnementaux. On distingue deux grandes stratégies :
- La thérapie génique in vivo : cette approche consiste à introduire directement du matériel génétique dans l’organisme du patient. Dans 89 % des cas, c’est un virus modifié qui joue le rôle de vecteur, transportant le gène thérapeutique jusqu’aux cellules cibles.
- La thérapie génique ex vivo : les cellules du patient sont prélevées, modifiées génétiquement en laboratoire, puis réinjectées. Parmi les thérapies ex vivo, 76 % sont basées sur des cellules T, un type de globules blancs essentiels au système immunitaire.
Au sein des biothérapies, qui regroupent toutes les approches médicales basées sur l’utilisation de cellules vivantes ou de composants biologiques, la thérapie génique représente aujourd’hui 16 % des recherches cliniques avancées.
Parmi les nombreux essais cliniques menés sur les thérapies géniques, l’oncologie représente le domaine de recherche le plus dynamique. En Europe, la recherche sur le cancer concerne :
- un tiers des thérapies géniques in vivo ;
- et 86 % des thérapies géniques ex vivo.
Deux approches thérapeutiques sont possibles.
L’immunothérapie autologue consiste à prélever des cellules immunitaires du patient, à les modifier génétiquement en laboratoire de façon à renforcer leur capacité à éliminer les cellules cancéreuses, puis à les réinjecter dans l’organisme. Parmi ces approches, les thérapies CAR-T (Chimeric Antigen Receptor-T cells) représentent une avancée majeure. Elles consistent à modifier génétiquement des lymphocytes T du patient afin de produire un récepteur antigénique à leur surface, ce qui les rend capables de reconnaître les cellules cancéreuses et de les détruire. La thérapie génique représente ici un formidable moyen de donner au système immunitaire la capacité de combattre par lui-même le cancer.
D’autre part, les thérapies géniques contre le cancer peuvent également utiliser des virus génétiquement modifiés, capables de cibler spécifiquement les cellules tumorales, afin de contribuer à leur destruction et de stimuler la réponse immunitaire du patient vis-à-vis de ces cellules cancéreuses.
Si la recherche clinique s’est d’abord révélée prometteuse pour les cancers du sang (dont les lymphomes, les myélomes et les leucémies), les thérapies géniques en cours de développement ciblent aujourd’hui également différentes tumeurs solides, affectant notamment l’ovaire, le cerveau, le poumon, le pancréas ou encore le côlon.
En France, plusieurs thérapies CAR-T sont déjà autorisées et utilisées pour traiter certains cancers du sang, notamment les lymphomes et les leucémies, chez l’adulte comme chez l’enfant. À ce jour, environ 4 000 patients ont pu bénéficier de ces traitements innovants.
Si les CAR-T ont d’abord été développées dans le cadre de l’oncologie, elles suscitent aujourd’hui un intérêt croissant dans d’autres domaines thérapeutiques. Des études explorent actuellement leur potentiel dans le traitement des maladies auto-immunes, avec des résultats très prometteurs.
Les thérapies CAR-T pourraient notamment permettre de soigner le lupus sévère, une maladie où le système immunitaire attaque divers organes et tissus, entraînant des inflammations chroniques et de multiples complications.
Ces thérapies géniques sont également prometteuses pour les myosites inflammatoires qui provoquent une inflammation chronique des muscles, entraînant une faiblesse musculaire progressive et des douleurs invalidantes.
Enfin, la thérapie CAR-T pourrait permettre de traiter la sclérodermie, une maladie caractérisée par un durcissement anormal de la peau et des tissus conjonctifs, pouvant également affecter les organes internes et altérer leur fonctionnement.
Ces avancées ouvrent la voie à une diversification des indications des thérapies CAR-T et renforcent l’idée que la thérapie génique est amenée à transformer durablement la médecine.
Les nouvelles frontières de la thérapie génique : au-delà du cancer
Au-delà du cancer, la recherche en matière de thérapie génique cible de très nombreux autres domaines médicaux avec des avancées notables.
En ophtalmologie, plusieurs traitements sont déjà disponibles, notamment pour la neuropathie optique héréditaire de Leber, la rétinite pigmentaire et l’amaurose congénitale de Leber. Par ailleurs, des essais prometteurs sont en cours pour la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA, forme humide), une maladie qui touche entre 1,5 et 2 millions de personnes en France.
Dans le domaine des troubles neurologiques, la thérapie génique a déjà permis des avancées pour des maladies graves comme l’atrophie musculaire spinale (ASM), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et l’adrénoleucodystrophie cérébrale. Ces succès ouvrent des perspectives pour d’autres pathologies plus répandues, notamment la maladie de Parkinson, actuellement en phase d’essais cliniques. La thérapie génique est également explorée pour la maladie d’Alzheimer. Mais pour cette pathologie neurodégénérative complexe, impliquant de multiples facteurs génétiques et environnementaux, les recherches en sont encore à un stade expérimental.
Des applications innovantes émergent également dans les domaines des infections virales et bactériennes. Un essai clinique américain lancé en 2022 explore une approche basée sur CRISPR (une technologie de modification génétique nommée « ciseaux moléculaires »), pour cibler et éliminer le VIH des cellules infectées.
En ce qui concerne les maladies métaboliques, la thérapie génique est envisagée par exemple pour le diabète de type 1, grâce à l’implantation de cellules pancréatiques génétiquement modifiées.
Dans le domaine cardiovasculaire, des recherches sont en cours pour traiter des pathologies comme l’ischémie des membres, la maladie vasculaire périphérique ou encore l’angine de poitrine.
Enfin, des développements prometteurs concernent de nombreuses autres maladies, notamment des infections urinaires et génitales chroniques, des troubles musculo-squelettiques, ainsi que des pathologies dermatologiques et respiratoires.
Conclusion
Les thérapies géniques s’imposent aujourd’hui comme un levier majeur de transformation de la médecine moderne. D’abord cantonnées aux maladies génétiques rares, elles se développent désormais dans de nombreux domaines, de l’oncologie aux pathologies neurologiques, en passant par les maladies auto-immunes et infectieuses. Cette évolution ouvre des perspectives de traitement inédites pour de très nombreux patients.
Article rédigé en partenariat avec le LEEM