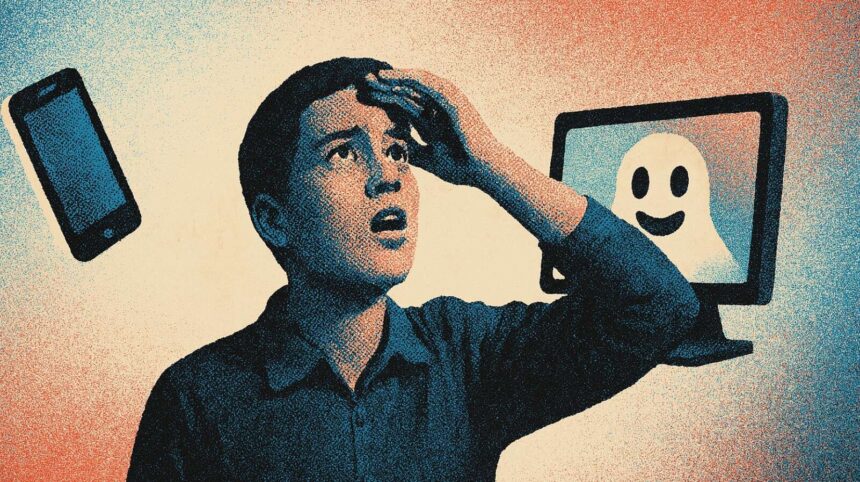Si on vous parle de désinformation, quelle est la chose qui vous vient à l’esprit en premier ? Il est fort à parier que ce soit les fake news. Depuis une dizaine d’années, cet anglicisme s’est largement propagé dans les usages de la langue française. La lutte contre ces fake news est désormais institutionnalisée, notamment à l’aide de l’éducation aux médias et à l’information (EMI) dans les établissements de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Pour justifier cela, certains suggèrent que nous sommes entrés dans l’ère de la post-vérité, d’autres pointent du doigt les partis politiques populistes – notamment ceux d’extrême droite – dont les stratégies de dissémination de fausses informationsfausses informations sont désormais bien documentées. Tout cela cristallise une crainte collective à l’égard des fake news ou plus précisément d’une crainte que les individus y adhèrent.
Sur quoi repose l’hypothèse de la crédulité ?
Pour que cette crainte soit justifiée, il faut tenir pour vrai le fait que nous soyons – en moyenne – plus crédules que sceptiques. En effet, il n’y aurait aucune inquiétude à avoir si nous pensions que la plupart des gens adhéraient aux true news, n’adhéraient pas aux fake news et savaient bien faire la différence entre les deux.
Cette crédulité se teste, notamment en mesurant les évaluations des individus dans des tâches expérimentales dédiées, où ils doivent juger – généralement sur la base d’un titre et d’un encadré – la véracité ou la fausseté d’une information. Ces mesures peuvent être résumées en deux grands indicateurs : l’indicateur de discernement (on soustrait la moyenne des jugements ayant considéré les fake news comme étant vraies à la moyenne des jugements ayant considéré les true news comme étant vraies – un score élevé suggère alors un bon discernement) et celui de scepticisme/crédulité (on regarde la distance qui sépare cette même moyenne de l’idéal à atteindre, c’est-à-dire d’un jugement de fausseté pour l’ensemble des fakes news et d’un jugement de véracité pour l’ensemble des true news).
Nous sommes – en moyenne – plus sceptiques que crédules
Ces deux indicateurs ont été calculés dans une récente méta-analyse, publiée dans la revue Nature Human Behaviour, rassemblant les données de 67 études expérimentales, réalisées dans plus de 40 pays à travers les six continents, même si la grande majorité des études proviennent des États-Unis ou d’Europe. Son résultat principal pourrait être formulé de la façon suivante : lorsque nous devons évaluer une information, nous estampillons plus facilement le label « faux » que le label « vrai ». En effet, le score de discernement moyen est de 0,24 (0,6 – 0,36), et celui de scepticisme/crédulité est de 0,4 et 0,36, respectivement.
Qu’est-ce que cela veut donc dire ? En moyenne, nous jugeons plus souvent comme vraies les true news que les fake news et nous rejetons excessivement les true news. Selon les auteurs, cela suggère que nous pêchons par excès de scepticisme et non de crédulité. Pour autant, il faut nuancer ce propos général. Dans la méta-analyse, d’autres indicateurs nous informent que si l’effet du discernement sur notre capacité à distinguer le vrai du faux est élevé, c’est moins le cas pour l’effet du scepticisme. En effet, il semblerait que cette tendance sceptique soit plutôt le fait de différences entre les individus dans l’échantillon de près de 200 000 participants.
Néanmoins, si on considère la portée de ces résultats, il serait souhaitable que les interventions visant à améliorer la confiance envers les vraies informations prennent un peu plus de place dans la lutte contre la désinformation. Dans cette optique, le fact-checking (vérification des faits) par la foule est un outil complémentaire au fact-checking des journalistes.
Des effets variables selon plusieurs facteurs
Ces effets généraux sont bien évidemment sensibles à des modérateurs, c’est-à-dire d’autres variables qui vont venir influencer les scores susmentionnés. Dans l’étude, on peut citer les échelles de mesure qui peuvent donner des résultats différents, le format de présentation de l’information qui va également jouer un rôle (par exemple, les informations de type réseaux sociaux augmentent l’effet du scepticisme) ou encore le fait qu’une information soit nouvelle et discordante avec nos opinions politiques. Cela illustre la complexité qui se cache en réalité derrière des tendances moyennes.
Ces tendances ne sont d’ailleurs pas le seul élément présenté dans la méta-analyse. Pour un certain nombre d’études, les chercheurs disposaient également des données brutes, donc directement exploitables. Ils ont calculé des scores de discernement et de scepticisme, non pas en moyenne mais pour chacun des participants. Dès lors, ils montrent que près de 80 % des participants ont un score de discernement positif et que près de 60 % ont un score de scepticisme positif. Des résultats qui viennent donner du grain à moudre à leur hypothèse initiale.
Une question de motivation ?
Pourtant, une question reste en suspens : si on en croit les auteurs, nous semblons posséder les outils pour nous prémunir contre les fake news. Ils posent alors la question suivante : « pourquoi tombons-nous quand même dans leur piège de façon significative ? ». Selon les auteurs, c’est probablement une question de motivation à faire preuve d’esprit critique.
Dans un autre article récent publié dans la revue Philosophical Psychology, l’autrice principale et son co-auteur proposent un modèle temporel de l’esprit critique ainsi que des pistes pour réfléchir à la façon de rendre ce processus coûteux plus plaisant. La lutte contre la désinformation passera nécessairement par ces deux axes : accroître la confiance envers les vraies informations afin de ne pas perdre son temps à tout vérifier, et accroître la motivation des individus à aller vérifier les informations ambiguës ou potentiellement trompeuses.
Le live de Futura : Savons-nous vraiment ce qu’est l’esprit critique ? © Futura, YouTube
Les implications politiques et scientifiques de cette méta-analyse
Les implications de cette méta-analyse sont doubles, d’un point de vue de l’intervention politique et de la recherche. Côté politique, elle met en exergue l’intérêt de se concentrer au moins autant, si ce n’est davantage, sur des interventions visant l’acceptation des true news. Côté recherche, elle suggère qu’il faudrait que chaque étude testant des interventions contre la désinformation mesure leurs effets à la fois sur la susceptibilité envers les fake news, comme il est coutume de le faire car c’est généralement l’objectif principal, mais aussi sur l’acceptation des true news. En effet, à la manière d’un médicament, une intervention efficace ne se résume pas à avoir un effet sur la cause ou le symptômesymptôme à traiter, mais elle doit également avoir une balance bénéfice-risque acceptable. Dès lors, si ces interventions engendrent plus de scepticisme envers les true news, on peut se poser la question de leur utilité.
Enfin, rappelons les limites inhérentes à ce type de méta-analyse : elle se base sur des données expérimentales qui miment de façon très imparfaite la façon dont nous jugeons la véracité d’une information dans le monde réel. Par conséquent, elles manquent de validité externe.
De plus, les résultats sont également le reflet de la diversité des choix des auteurs et des autrices de chaque étude indépendante concernant le type d’informations présentées et, par conséquent, une généralisation de ces résultats à l’ensemble des informations que l’on peut rencontrer est impossible.