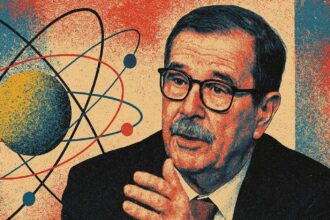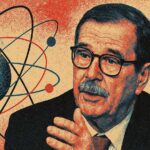C’est un fait, le cerveau humain a progressivement augmenté tout au long de l’histoire humaine, en parallèle de l’évolution de nos capacités cognitives. Pourtant, le lien entre les deux n’est pas si clair, surtout quand on compare les différentes espèces humaines qui se sont succédé au fil du temps. Une nouvelle étude révèle ainsi quels mécanismes ont participé à cette évolution.
Quand on considère l’ensemble de l’histoire humaine, depuis les premiers hominidéshominidés jusqu’à nous, une chose est frappante. L’augmentation des capacités cognitives et la complexification des liens sociaux ont évolué de manière parallèle à une augmentation de la taille du cerveau. Ce processus d’encéphalisation durant l’évolution humaine est cependant depuis longtemps débattu. Le lien entre intelligenceintelligence et taille du cerveaucerveau n’est ainsi pas forcément évident lorsque l’on regarde à petite échelle.
Malgré son très petit volume crânien, HomoHomo floresiensis était déjà très bon navigateurnavigateur. Et l’on doit l’invention des premiers outils à Australopithèque. NéandertalNéandertal avait, quant à lui, un cerveau plus imposant que le nôtre, mais présentant une structure différente. La taille ne semble donc pas être l’unique raison expliquant l’émergenceémergence de nouvelles compétences. La forme du cerveau, mais aussi son organisation interne, et d’autres paramètres biologiques entrent ainsi certainement en ligne de compte.
Évolution de la taille du cerveau au cours du temps : quels facteurs d’influence ?
Outre le fait que le lien entre taille du cerveau et intelligence est encore mal compris, de nombreuses questions existent encore concernant l’évolution même de la taille du cerveau au cours du temps et sur les processus qui l’influencent. Sur la base d’observations archéologiques de différentes espècesespèces humaines, certaines études ont ainsi supposé que la croissance de la taille du cerveau a évolué de manière graduelle au cours du temps. Pour d’autres chercheurs, elle aurait plutôt progressé par paliers. Ces discussions reflètent en réalité l’existence d’un débat plus profond : l’évolution humaine a-t-elle été graduelle ou saccadée ? De plus, l’influence qu’ont pu avoir différents processus évolutifs, comme la séparationséparation des lignées ou l’émergence de deux nouvelles espèces à partir d’une espèce ancestrale commune, est encore floue.
Une nouvelle étude apporte cependant de nouveaux éléments de réponse. Pour dresser un nouveau schéma évolutif de la taille du cerveau, des chercheurs ont analysé de nombreuses données de volumes crâniens sur 7 millions d’années, mais en faisant attention de dissocier la dynamique des changements se produisant au sein des espèces, et celle se produisant entre les espèces.
Une croissance graduelle au sein de chaque espèce
Leur analyse, publiée dans la revue PNAS, montre que si l’on se concentre sur une espèce en particulier, on observe à chaque fois une croissance graduelle de la taille du cerveau. Celle-ci aurait été influencée par des facteurs génétiquesgénétiques, environnementaux et comportementaux. Ainsi, les réseaux sociaux, le développement de la culture et de nouvelles technologies ou encore l’apparition et le développement du langage auraient agi au sein d’une boucle de rétroactionboucle de rétroaction positive. Ces éléments auraient en effet renforcé certaines pressions sélectives, favorisant des capacités cognitives plus avancées permettant le développement de comportements plus complexes, ce qui en retour aurait entrainé le développement de cerveaux plus gros.
Il apparaît ainsi que cette croissance de la taille du cerveau se serait accélérée pour les lignées les plus récentes. Les chercheurs soulignent que les variations observées entre les espèces sont en réalité associées à des différences de masse corporelle : les espèces de grande taille ayant naturellement un cerveau plus gros. Comparer les espèces entre elles entraîne donc un certain biais.
Et l’impact du climat ?
Les chercheurs se penchent désormais sur la question de l’influence du climatclimat. Les conditions climatiques et leurs variations au cours du temps sont en effet suspectées depuis longtemps avoir joué un rôle sur l’encéphalisation. Mais cette hypothèse reste encore à être prouvée. Des résultats préliminaires laissent cependant penser que des climats froids et des températures variables pourraient avoir participé à la croissance du volume cérébral au sein des différentes espèces, en les poussant notamment à développer des stratégies de protection.