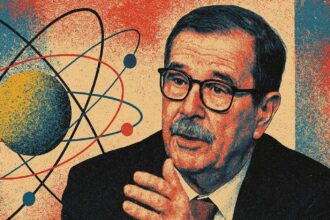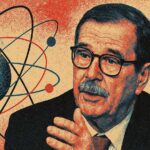Pendant une grande partie de l’histoire de notre Terre, l’Arctique et l’Antarctique étaient dépourvus de glace. C’est ce que confirme une étude publiée récemment dans la revue Science Advances. « L’implication importante ici est que le mécanisme naturel de régulation du climat de la Terre semble favoriser un monde chaud et riche en CO2, sans calotte glaciairecalotte glaciaire, et non le monde partiellement glaciaire et relativement pauvre en CO2 que nous connaissons aujourd’hui », explique, dans un communiqué, Benjamin Mills, professeur d’évolution du système terrestre à la School of Earth and Environment de l’université de Leeds (Royaume-Uni) qui a supervisé les travaux. De quoi nous éviter les épisodes de glaciationglaciation mondiale, de type « Boule de neige », et permettre à la vie de prospérer. Et à la lumièrelumière de cette information, quelques climatosceptiques pourraient être tentés de demander pourquoi, alors, nous devrions aujourd’hui nous inquiéter de la fontefonte des calottes polaires.
« Il y a un message important à retenir, à savoir que l’état actuel de notre Terre n’a été atteint que par une heureuse coïncidence. Si nous poussons le réchauffement climatique trop loin, rien ne garantit que nous pourrons retrouver les conditions de vie que nous apprécions. Car si notre Planète aime la chaleurchaleur, nos sociétés l’aiment beaucoup moins. L’état actuel de la Terre, recouvert de glace, n’est pas typique de l’histoire de notre Planète. Mais notre société en dépend. Nous ne devons pas nous attendre à ce que notre Terre revienne simplement à un état froid comme c’était le cas à l’ère préindustrielle lorsque nous cesserons enfin nos émissionsémissions de gaz à effet de serre », prévient Benjamin Mills.
La glace de mer à des niveaux historiquement bas
Et comme pour appuyer sa mise en garde, plusieurs signaux d’alarme sont passés au rouge. Celui de la glace de mer, en premier lieu. Jamais l’étendue de la banquise n’avait en effet été aussi réduite. L’effet combiné de l’airair chaud, de mers tout aussi chaudes et de vents qui brisent la glace. En ArctiqueArctique, la glace de mer est à son niveau le plus bas jamais enregistré par les satellites – qui observent pourtant la région depuis la fin des années 1970. Près de 0,2 million de kilomètres carrés de glace en moins que le précédent record.
L’AntarctiqueAntarctique avait jusqu’à récemment montré des signes rassurants de résiliencerésilience. Mais tout indique aujourd’hui que la région est entrée dans un nouveau régime. Sans le réchauffement climatiqueréchauffement climatique, le record de niveau le plus bas de la banquise, établi en 2023, aurait dû correspondre à un événement qui ne se reproduit que tous les 2 000 ans. En ce début d’année 2025, il est à deux doigts de tomber à nouveau !
Si vous êtes de ceux qui pensent tout bas « tant pispis pour les ours polaires et les manchots », rappelons tout de même que ce qui se passe aux pôles ne reste pas aux pôles. La fonte de la banquise a un effet direct sur le climat mondial. Car la glace, en renvoyant efficacement le rayonnement solairerayonnement solaire vers l’espace, aide à maintenir une certaine fraîcheur sur notre Terre. Ainsi une étude publiée l’année dernière dans les Geophysical Research Letters nous apprend que la banquise a déjà perdu environ 14 % de son pouvoir refroidissant depuis les années 1980. Et c’est sans parler, un peu plus égoïstement, du rôle de la glace de mer dans le maintien de notre climat européen plutôt tempéré.
Un déclin important aussi au niveau des glaciers
Un consortium international nommé Glambie vient, de son côté, de publier, dans la revue Nature, une nouvelle estimation de la fonte des glaciers dans le monde sur la période 2000-2023. « Il y a trois ans, nous avions déjà publié une première évaluation exhaustive des pertes de massemasse des glaciersglaciers , nous précise Fanny Brun, chercheuse à l’Institut des géosciences de l’environnement (IGEIGE) de l’université Grenoble Alpes. Cette évaluation se basait sur des mesures satellites issues d’un seul capteurcapteur. » De quoi estimer l’étendue de la fonte des glaciers sur des périodes de 10 ans. « Nous avions ainsi déjà noté une accélération entre la période 2000-2010 et la période 2010-2020. »
Cette fois, les chercheurs, dont Etienne Berthier, du CNRS, ont mobilisé des données de diverses natures. « Des mesures par satellites avec des capteurs très différents et des mesures de terrain – pour une toute petite part des glaciers seulement, malheureusement. Le tout pour accéder en plus, grâce à des mesures en continu, à une échelle annuelleannuelle de l’évolution des glaciers », nous explique Fanny Brun. Résultat, l’accélération de la perte de masse des glaciers se confirme sur les 23 années analysées. Mais ces mesures à haute définition temporelle permettent surtout de faire apparaître un déficit spectaculaire sur 2022 et 2023.
Les glaciers d’Europe en grand danger
« Certains glaciers dans le monde, notamment ceux de notre Europe, avaient déjà commencé à apparaître en déséquilibre avec le climat au début des années 2000. Dans certaines régions d’Asie, par exemple, on observait, en revanche, des glaciers qui pouvaient gagnaient un peu de masse. Mais à partir de 2010, nous avons basculé dans un autre monde où toutes les régions sont devenues déficitaires », nous raconte Fanny Brun. Ainsi, depuis le début de notre siècle, les glaciers du globe ont perdu 5 % de leur volumevolume, soit 273 milliards de tonnes de glace chaque année. Ou encore, l’équivalent de trois piscines olympiques par seconde !
« Les glaciers des Pyrénées et des Alpes ont connu, en 2022 et 2023, deux années bien plus extrêmes que les glaciers du reste du monde. Entre 2000 et 2020, ils avaient perdu environ 1 mètre d’eau par an. Comme si on rabotait toute la surface des glaciers d’un mètre chaque année. Sur les deux dernières années, la perte de masse enregistrée est de… 3 mètres ! Le résultat sans doute d’un hiverhiver très déficitaire en précipitation en 2022 et d’une année 2023 particulièrement chaude. » Jusqu’à ce que 2024 vienne la détrôner, rappelons qu’elle avait occupé la place d’année la plus chaude jamais enregistrée.
« Les glaciers des Alpes connaissent une situation de léger déséquilibre avec le climat depuis les années 1980. Parce qu’ils sont situés à des altitudes relativement faibles. Mais depuis les années 2000, le déséquilibre est devenu plus marqué. En moins de 25 ans, ils ont perdu environ 40 % de leur volume. Dont 10 % rien que ces deux dernières années. »
Ce que nous réserve l’avenir
Alors combien de temps reste-t-il à nos glaciers ? « Il faut surtout retenir que chaque demi-degré de réchauffement compte, insiste Fanny Brun. Dans un monde à +1,5 °C à l’horizon 2100, on perd environ un quart de la masse des glaciers du globe. Dans un monde à +4 °C, on en perd 40 %. Avec de fortes disparités régionales. Concernant les glaciers européens, par exemple, on voit bien qu’on s’achemine déjà vers une disparition quasiment complète. Si on dépasse le seuil fixé par l’Accord de Paris sur le climat, il n’y a plus aucun espoir. En Alaska, en revanche, la moitié des glaciers peut encore être sauvée. Mais si nous montons à +4 °C, ce sont les deux tiers, voire les trois quarts, de ces glaciers qui vont disparaître. »
Le saviez-vous ?
Fanny Brun tient à faire passer un message : « Il est important que les agences spatiales, qu’elles soient française, européenne ou américaine, continuent de porter des missions qui permettent de réaliser un suivi de l’évolution des glaciers. Car l’un des capteurs qui nous a servi pour cette dernière étude, par exemple, renvoie des données depuis l’an 2000. Il devait fonctionner six ans. Vingt-cinq ans plus tard, nous nous attendons à ce qu’il s’arrête prochainement. Il est donc crucial que d’autres missions puissent prendre le relais. Sur le terrain aussi, il faut poursuivre les efforts, portés souvent par des organismes nationaux. En France, les financements sont pérennes. Mais ce n’est pas le cas partout dans le monde. »
S’il est tellement important de poursuivre ce type de travaux, c’est évidemment pour faire avancer la science. Pour nourrir les modèles qui prévoient les évolutions de notre Planète dans le contexte de réchauffement climatique, par exemple. Mais il y a également des raisons bien plus pragmatiques. « Il faut savoir que les glaciers sont les premiers contributeurs à la hausse du niveau de la mer, hors dilatationdilatation thermique », nous indique Fanny Brun. Comprenez que la fonte des glaciers de montagne contribue actuellement à la montée des eaux juste un peu moins que le phénomène physiquephysique qui veut que l’eau occupe un volume plus important lorsque les températures grimpent. Mais plus que la fonte de l’Arctique ou encore que celle de l’Antarctique. « Parce que ce réservoir de glace est extrêmement réactifréactif et que les glaciers perdent donc désormais énormément de masse. »
Plus localement, la fonte des glaciers a des conséquences pour la ressource en eau. Sur certains bassins versantsbassins versants des Andes ou de l’Asie centrale. Dans le bassin de l’Indus, par exemple, au Pakistan. Parce qu’il est alimenté de façon substantielle par la fonte des glaciers.
« La dernière conséquence, c’est qu’on perd un patrimoine naturel qui ne reviendra pas. Les enfants qui naissent aujourd’hui ne connaîtront jamais les beaux paysages des Alpes », conclut Fanny Brun.