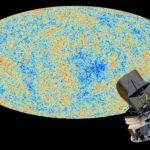Depuis la découverte des premières exoplanètes en 1992 autour d’un pulsar et 51 Pegasi B en 1995, on compte aujourd’hui 7 434 planètes référencées, dont certaines se trouvent dans la zone d’habitabilité de leur étoile. De plus, il semble a priori que tous les types de planètes potentiellement existants ont désormais été découverts.
L’idée d’envoyer des sondes pour étudier ces planètes in situ prend de plus en plus d’ampleur dans la communauté scientifique. Bien que les télescopes terrestres et spatiaux nous fournissent déjà des données précieuses sur la composition atmosphérique et les conditions environnementales de ces exoplanètes, ces observations ne remplacent pas l’analyse directe. Les informations recueillies par des sondes envoyées sur place pourraient non seulement enrichir notre compréhension, mais aussi nous permettre d’évaluer leur potentiel d’habitabilité. Au-delà de cette évaluation, il existe même un espoir de découvrir des formes de vie ou, mieux encore, des techno-signatures, témoignant de l’activité d’une intelligenceintelligence avancée.
Un colloque pour l’avenir de l’exploration interstellaire
En octobre 2025, un colloque sera organisé pour discuter de ces projets de sondes interstellaires. Cet événement rassemblera des scientifiques pour échanger des idées et des perspectives sur l’avenir de l’exploration interstellaire et des exoplanètes. Parmi les études qui seront mises en avant, citons celle de Marshall Eubanks de l’entreprise américaine Space Initiative : « The in situ search for bio and technosignatures in the Proxima Centauri system ».
Cette étude propose une mission interstellaire ambitieuse, visant à explorer le système Alpha Centauri : le système stellairesystème stellaire le plus proche de notre propre Système solaireSystème solaire. L’exploration de ce système pourrait ouvrir de nouvelles perspectives sur la formation des systèmes planétaires et sur la possibilité de rencontrer des formes de vie au-delà de la Terre. Les résultats de cette mission pourraient transformer notre compréhension de l’UniversUnivers et de notre place dans celui-ci.
Pour nous parler de cette étude, nous avons interviewé Jean Schneider, éminent spécialiste des exoplanètes et chercheur au Laboratoire d’étude de l’Univers et des phénomènes extrêmes (LUXLUX) de l’Observatoire de Paris. Auteur de l’Encyclopédie des exoplanètes extrasolaires, devenue au fil du temps la référence mondiale du recensement de ces objets, Jean Schneider a également participé à des études de missions interstellaires.
L’objectif principal est « d‘étudier Proxima CentauriProxima Centauri, une naine rougenaine rouge la plus voisine du SoleilSoleil (4,24 années-lumièreannées-lumière), et en particulier Proxima Centauri b et Proxima Centauri d, deux exoplanètes situées dans sa zone habitable », nous explique Jean Schneider. La mission cherche à répondre à une question fondamentale : « Existe-t-il des signes de vie ou de civilisations technologiques dans ce système voisin ? ».
Le système Alpha du Centaure (α Centauri), composé de la naine rouge Proxima Centauri et de la binairebinaire Alpha Centauri A et B, est une cible idéale pour cette mission. Il s’agit « d’un système qui combine à la fois un système binairesystème binaire et un système simple, des étoiles de type solaire et une naine rouge ». Cela en fait une « excellente cible en raison de sa proximité et de la diversité de ses étoiles et planètes », tient à préciser Jean Schneider. Une planète (Proxima-b) évolue dans la zone d’habitabilité de Proxima Centauri, qui rappelons-le est l’étoile la plus proche du Soleil. On suppose aussi qu’Alpha Centauri A pourrait avoir une planète de la massemasse de NeptuneNeptune, actuellement appelée Candidate-1, dans sa zone d’habitabilité.
Pour atteindre cet objectif, l’étude propose d’envoyer un « essaim » de petits engins spatiaux appelés « picospaces », propulsés par des laserslasers à énergieénergie dirigée, et travaillant de concert pour collecter un maximum d’informations. Cet essaim pourrait « compter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de petits picospaces ». Un si grand nombre de satellites peut surprendre, mais il améliore les chances de réussite de la mission car il « permet une forte probabilité qu’au moins une partie des sondes passera à proximité de la cible ». Ces satellites de quelques grammes représentent un compromis ingénieux « entre l’envoi d’un grand nombre de sondes légères et un nombre plus limité de sondes plus massives, dotées d’une plus grande autonomieautonomie ».
Défis et ruptures technologiques
Cependant, la réalisation d’une telle mission se heurte à plusieurs défis majeurs, ou « points durs ». Le premier est « la nécessité d’une navigation et d’un ciblage d’une précision extrême ». Sur des distances interstellaires, une infime erreur de pilotage ou de navigation peut entraîner un écart de plusieurs milliards de kilomètres par rapport à la cible. Or, aujourd’hui, la « position, la valeur et la direction de la vitessevitesse de Proxima ne sont pas encore connues avec la précision suffisante pour viser juste ». C’est donc un sujet de préoccupation majeur auquel l’astronomeastronome Pierre Kervella, spécialiste de l’astrométrie au Laboratoire d’instrumentation et de recherche en astrophysiqueastrophysique, contribue à les préciser.
Pour qu’au moins une sonde passe à proximité de la planète ciblée, il est « impératif de minimiser les erreurs d’éphémérides (positions prédites), d’éviter la navigation relativiste terminale, et de déterminer les informations de Proxima Centauri avec une précision de parallaxeparallaxe d’environ 1 μas (microseconde d’arc) ». L’étude suggère d’utiliser l’imagerie relativiste et les microlentilles pour la navigation, ainsi que le chronométrage des pulsars à rayons Xrayons X pour améliorer la précision du positionnement.
La coordination des essaims et de la « faisabilité des communications pour renvoyer les données sur Terre est crucial ». Plusieurs options sont proposées dont des sondes indépendantes, « c’est-à-dire que chaque sonde transmet des données de manière autonome, augmentant le volumevolume total de données » ; un essaim cohérent dans le temps, « c’est-à-dire que les sondes arrivent presque simultanément et coordonnent la transmission de données pour améliorer le débitdébit de données » ; ou une approche plus avancée dans laquelle les « sondes se verrouillent en phase pour créer une ouverture synthétique, mais cette option est jugée trop difficile en raison des défis de coordination de phase ».
Retours scientifiques prévus : des informations inédites dans de nombreux domaines
En matièrematière de retour scientifique, l’équipe de l’étude prévoit « des avancées significatives dans de nombreux domaines », tant pendant le trajet vers α Centauri qu’à l’arrivée. Et ce malgré la faible masse des picospaces qui impose de « très fortes contraintes sur les instruments de mesure et d’observation embarqués à bord des satellites ». Entre le lancement et la destination, les sondes auront 21 ans pour observer diverses cibles.
Pendant le vol, les sondes pourront effectuer diverses observations scientifiques dans le domaine de l’astrométrie, « qui consiste à mesurer les positions et les mouvementsmouvements des étoiles », les occultationsoccultations stellaires, « ce qui permet d’observer les objets du Système solaire et les astéroïdesastéroïdes », la détection des corps proches, en « utilisant les déviations de trajectoire pour détecter des corps inconnus ». Les scientifiques viseront aussi à explorer le nuage d’Oortnuage d’Oort, le milieu interstellaire et étudier les propriétés de la géo-couronne terrestre, la poussière interstellaire, etc. À leur arrivée dans le système α Centauri, les sondes seraient chargées « d’imager Proxima Centauri b, avec une résolutionrésolution de l’ordre du gigapixel, d’analyser son atmosphèreatmosphère et de rechercher des preuves de biologie ou de technologie ». On s’attend à des images avec une résolution de 200 mètres et même de seulement 6 mètres sur une partie de la surface de Proxima b.
La mission prévoit également l’étude d’autres corps célestes dans le système, comme des astéroïdes et des luneslunes potentielles. Elle offre aussi des « opportunités uniques pour l’héliophysique avec trois étoiles différentes ». Dans le domaine de la physiquephysique fondamentale, une variété d’objectifs est envisagée, « allant des tests de la gravitégravité à l’étude des ondes gravitationnellesondes gravitationnelles ».
“Un lancement peut être envisagé à l’horizon 2050-2060”
Quant aux défis technologiques liés à une telle mission, plusieurs points durs sont évoqués dans l’étude, dont la « constructionconstruction de picospaces légers, le développement de systèmes de propulsion laser puissants et la gestion du volume important de données collectées ». Actuellement, cette idée « se situe à un niveau de maturité technologique de 3 sur l’échelle TRL (Technological Readiness Level) ». Afin de minimiser les risques associés à cette mission le plus haut niveau est requis, c’est-à-dire 9. Dans ce contexte, cette mission n’est pas envisagée avant plusieurs décennies, compte tenu également du coût : « un lancement peut être envisagé à l’horizon 2050-2060 ».
La propulsion par laser : Un pas vers les étoiles
Quant à la méthode de propulsion envisagée, il s’agit d’une voile photonique, tractant une sonde minuscule de quelques grammes tout au plus et tenant dans la main. Cette voile sera propulsée par des rayons laser envoyés depuis la Terre. Cette utilisation de la lumière, comme système de propulsion, est la seule façon d’atteindre les étoiles voisines à l’échelle d’une vie humaine. Cela dit, compte tenu de la distance dont il est question, tout de même 40 000 milliards de kilomètres, et du fait que la sonde devra atteindre environ 20 % de la vitesse de la lumièrevitesse de la lumière quand nos sondes actuelles ne dépassent pas les 0,01 %, la réalisation de ce laser basé sur Terre est le plus grand défi du projet.
Cela dit, cette future installation de lancement de laser « pourrait servir à d’autres missions et pas seulement pour le lancement de cet essaim de ces picospaces ». En effet, cette infrastructure pourrait offrir un large éventail de possibilités comme le « lancement de satellites de plus grande masse et de plus grande capacité, ainsi que des missions de reconnaissance uniques et faiblement massives ». Elle pourra également servir pour aller « au voisinage des quatre planètes telluriques récemment découvertes autour de la fameuse étoile de Barnard, qui n’est que 1,4 fois plus loin que Proxima ».