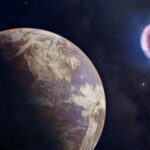La confiance est le cimentciment d’un bon fonctionnement social. Elle permet de se fier aux personnes avec qui nous faisons société, sans avoir à systématiquement vérifier ce qu’elles nous disent ou ce qu’elles font. C’est la condition sine qua non pour vivre ensemble. Si l’on peut affirmer, sans trop de doute, que la confiance envers le corps politique s’est émiettée, peut-on en dire autant de la confiance envers la science ? En effet, ces dernières années, notamment pendant et après la pandémie de Covid-19, on a pu voir se propager, dans les médias et les discours, l’idée qu’il y aurait une défiance généralisée envers la science ou plus exactement envers les scientifiques.
Une récente étude publiée dans Nature Human Behaviour, réunissant plus d’une centaine de chercheurs et chercheuses à travers le monde, a voulu mettre à l’épreuve cette affirmation. Leur conclusion est la suivante : non, il n’existe pas de crise de la confiance envers les scientifiques. Pour autant, certains facteurs peuvent pousser des groupes sociaux à l’être plus ou moins. Il n’y a donc pas de crise globale de la confiance, mais des causes venant moduler, de manière locale, cette confiance.
Mesurer la confiance envers les scientifiques
Les chercheurs et chercheuses à l’origine de l’article de recherche souhaitaient en premier lieu avoir un aperçu de la tendance générale dans le monde à faire confiance à la science et aux scientifiques. Pour mesurer cela, ils ont utilisé un questionnaire composé de 12 items englobant les quatre dimensions connues de la confiance : la compétence perçue, la bienveillance, l’intégritéintégrité et l’ouverture d’esprit.
Le questionnaire porteporte ouvertement sur la confiance envers les scientifiques car, comme les auteurs et autrices de l’article l’expliquent, le terme de science n’a pas de référent clairement identifié et sa représentation varie beaucoup d’un individu à l’autre. En orientant les questions vers les scientifiques plutôt que vers la science, ils se prémunissent de cette variabilité conceptuelle et d’éventuelles erreurs de mesure.
Leurs résultats montrent que la confiance envers les scientifiques est modérément élevée avec une moyenne globale de 3,62 sur une échelle allant de 1 (très faible) à 5 (très élevée) et qu’aucun pays ne montre de faible confiance envers les scientifiques, les résultats allant de 3,05 en moyenne pour l’Albanie et 4,3 en moyenne pour l’Égypte, la France obtenant le score moyen de 3,43. Généralement, les scientifiques sont perçus comme étant très compétents (moyenne globale à 4,02), relativement intègres et bienveillants (moyenne globale à 3,58 et 3,55 respectivement), mais moins ouverts à la contradiction (moyenne globale à 3,33). Aussi, 75 % des personnes interrogées sont d’accord avec le fait que les méthodes scientifiques sont le meilleur moyen de démontrer si quelque chose est vrai ou faux.
Les corrélats de la confiance et de la défiance envers les scientifiques
Pour autant, il serait inexact de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. En effet, les moyennes citées ci-dessus informent sur des tendances centrales, générales, qui ne permettent pas d’avoir une analyse fine de la situation. Par conséquent, elles ne disent rien sur les modérateurs qui conduisent à accorder, plus ou moins, sa confiance aux scientifiques. Les variables connues pour modérer ce lien et qui ont été investiguées à nouveau dans cette étude sont au nombre de quatre : l’attitude populiste, l’orientation à la dominance sociale, les buts prioritaires des sciences selon la population, et la façon dont ces dernières s’occupent de répondre à ces buts.
Le premier corrélat – l’attitude populiste – nie aux scientifiques leur statut d’experts et suppose qu’ils n’œuvrent pas pour le bien commun. Le deuxième corrélat – l’orientation à la dominance sociale – correspond à la tendance d’un individu à désirer et à supporter une hiérarchie sociale fondée sur l’idée qu’il existe des groupes inférieurs et des groupes supérieurs. En diffusant le savoir et dans le souhait d’une dynamique toujours plus horizontale avec la population, les scientifiques sont généralement perçus par les personnes ayant une forte orientation à la dominance sociale comme des personnes atténuant la hiérarchie entre les groupes. Les deux derniers corrélats n’ont pas besoin d’être explicités étant donné qu’ils expriment directement l’objet étudié dans l’étude.
Les résultats obtenus par les différentes équipes de recherche confirment certaines associations connues à travers le monde, comme celle entre les attitudes populistes et l’orientation à la dominance sociale, mais aussi les opinions politiques (la défiance est plus marquée chez les conservateurs et à la droite de l’échiquier politique) bien que cette dernière association ne soit pas valable dans tous les pays. Globalement, de nombreux résultats obtenus varient selon la zone géographique et le climatclimat géopolitique des pays dans lesquels ils sont obtenus.
Pour une science plus politique
La question de l’engagement des scientifiques dans la vie politique, qui est l’objet des deux derniers corrélats, est abordée favorablement par les personnes faisant confiance aux scientifiques, ce qui paraît logique. Pour autant, les priorités se chevauchent tandis que le budget pour les programmes de recherche, lui, reste limité. C’est là que l’on observe le côté éminemment politique des sciences, avec une partie de la population défendant l’idée que les plus grandes priorités sont la santé (4,49 de moyenne), les problèmes d’énergieénergie (4,38 de moyenne) et la réduction de la pauvreté (4,09 de moyenne). Ces priorités sont aussi différenciées selon les régions, avec parfois l’accent mis par la population sur la défense et la recherche militaire, comme en République démocratique du Congo (moyenne de 4,07).
Ici, on observe une différence entre la confiance et la perception de la façon dont la science sert l’intérêt général, selon les priorités que l’on juge être importantes. Par exemple, plus vous percevez que les efforts des scientifiques sont en accord avec vos valeurs (santé, lutte contre le changement climatique, les inégalités sociales, la pauvreté), plus vous aurez tendance à leur accorder votre confiance. En revanche, cette confiance peut baisser si vous percevez que ces efforts sont plutôt dirigés vers des valeurs antagonistes à vos convictions profondes. En Europe et dans les pays sud-américains, c’est notamment le cas des individus qui ont l’impression que les scientifiques axent trop leurs efforts sur la défense et la recherche militaire. Cela vient rappeler que les sciences ne se pratiquent jamais en vase clos et qu’une réflexivité politique de la pratique des sciences est essentielle pour ne pas perdre de vue les valeurs humanistes, dans ces temps troublés.